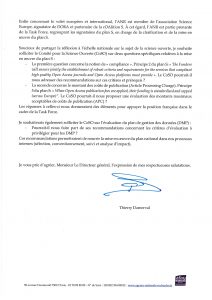Préconisations en vue de la mise en œuvre du Plan S
Contribution du Comité pour la science ouverte
Groupes “Édition scientifique ouverte” et “Construire la bibliodiversité”
Préambule
L’ANR, en tant que signataire du Plan S, s’engage à ce que les publications scientifiques qui résultent de recherches qu’elle a financées soient publiées en accès ouvert dans des revues ou sur des plateformes à compter du 1er janvier 2020 et que les auteurs de ces publications conservent sans aucune restriction leurs droits d’auteur.
Il s’agit là d’une avancée majeure vers l’accès ouvert, mais la mise en œuvre d’un tel engagement dans un délai aussi court ne peut se faire – pour simplifier – qu’en suivant initialement les deux voies déjà existantes et non exclusives :
- La première est de publier revues et ouvrages en accès ouvert (“Gold Open Access”), ce qui implique soit un financement institutionnel de plateformes ou revues portées par des établissements ou des communautés scientifiques (modèle “Diamond Open Access”), soit le paiement de frais de publication pour lesquels des modèles économiques respectant les principes du “Fair Open Access” devraient impérativement être mis en œuvre.
- La seconde est de rendre au moins possible sinon obligatoire le dépôt et la diffusion sans embargo de la publication dans des archives ouvertes fiables (“Green Open Access”).
Il est indispensable, tout en s’appuyant sur l’existant, d’envisager également le développement d’autres voies plus innovantes. En effet, le Plan S, tout en exprimant la nécessité d’établir des critères sévères de conformité pour les services des revues et plateformes éligibles, semble se focaliser sur l’hypothèse des “APC” : qui va les payer ? leur plafonnement ? sans envisager explicitement des modèles économiques alternatifs de type “Diamant” et en minorant le potentiel d’innovation éditoriale des archives ouvertes.
Par conséquent, l’ANR qui va devoir mettre en œuvre le Plan S doit prendre en compte dans sa feuille de route les revues en accès ouvert sans frais pour les auteurs, les modèles économiques alternatifs de type “Diamant” et les archives ouvertes, respectant ainsi la diversité des modèles prônée par l’Appel de Jussieu pour la science ouverte et la bibliodiversité qu’ont signé la majorité des établissements de recherche français.
C’est dans cette ligne que les groupes spécialisés du Comité pour la Science ouverte (Groupe “Édition scientifique ouverte” et Groupe-projet “Construire la bibliodiversité”), composés de chercheurs des diverses disciplines et de professionnels de l’information scientifique et technique (IST) ont réfléchi aux préconisations qui suivent, en vue d’une mise en application du Plan S en phase avec nos collègues européens. Des préconisations générales sont d’abord présentées, puis les 10 points du Plan S sont abordés dans l’ordre.
Le Comité pour la Science ouverte prend acte des précisions apportées au Plan S par le Guide d’application publié le 27 novembre 2018. Ces précisions lèvent certaines ambiguïtés et vont, pour la majorité d’entre elles, dans le sens des préconisations que le Comité énonce pour la mise en œuvre du Plan S par l’ANR.
Nous rédigeons cependant une courte note de “points de vigilance” répondant à la consultation en ligne de la cOAlition S en mettant l’accent sur les points éventuellement litigieux ou encore de notre point de vue imprécis du guide d’implémentation.
Nous recommandons qu’au moment de la mise en application du Plan S par l’ANR, une note très didactique soit publiée à destination des chercheurs afin de leur expliquer les nouvelles modalités de publication désormais compatibles avec les contrats ANR.
Préconisations générales pour une feuille de route
Affirmer le principe de bibliodiversité : pas de modèle unique. La science ouverte doit s’accompagner d’un soutien à la diversité des modèles économiques et des modèles de publication. Les principes énoncés dans l’Appel de Jussieu pour la science ouverte et la bibliodiversité devraient servir de support aux feuilles de route qui seront élaborées par les agences signataires du Plan S. À cet égard le point 1 du guide d’implémentation du Plan S rappelle qu’il est nécessaire de ne privilégier aucun modèle économique, ni aucune modalité de mise en œuvre de l’Open Access.
Respecter les spécificités des disciplines. Une attention particulière devra être portée aux pratiques et aux conditions de communication scientifique, de publication et d’évaluation des différentes disciplines. Les disparités SHS / STM devront notamment être prises en compte, y compris en ce qui concerne l’évaluation des chercheurs.
Prévoir un déploiement phasé. Si l’objectif 2020 peut être atteint de façon réaliste en s’appuyant majoritairement sur le potentiel de diffusion des archives ouvertes, seul le financement d’infrastructures, plateformes et revues innovantes et sous le contrôle de la communauté scientifique, permettra le changement systémique nécessaire, en complémentarité avec les archives ouvertes.
Affirmer et conforter le rôle primordial des archives ouvertes.
- Le dépôt en archive ouverte, sans cession exclusive de droits aux éditeurs et sans embargo, doit être mentionné explicitement comme l’une des solutions à promouvoir, voire à privilégier (cf.
point 8). - Le soutien aux archives ouvertes (HAL, archives institutionnelles et archives disciplinaires, nationales et internationales…) doit être systématisé, leur interopérabilité devant être un critère
de conformité.
Là aussi le guide d’implémentation, dans son point 2, précise que le dépôt en archives ouvertes permet d’être en conformité avec le Plan S.
Mettre en œuvre des mécanismes de soutien à l’innovation destinés aux infrastructures nationales et internationales, presses universitaires et structures éditoriales, plateformes de contenus ou de signalement, revues et services proposant des modèles éditoriaux et économiques originaux et répondant aux critères d’exemplarité tels qu’ils seront définis par le Comité pour la Science ouverte (CoSO) à échéance du premier semestre 2019. Il convient en particulier d’encourager les dynamiques d’évolution des revues de recherche portées ou soutenues par les établissements publics vers des modèles ouverts (cf. points 2 et 3).
En ce sens les affirmations du point 4 du guide d’implémentation du Plan S rejoignent les propositions du CoSO.
Exiger la mise en oeuvre de principes de transparence et de mesure des coûts de l’accès ouvert. C’est un point clé de la mise en place et de l’évolution des dispositifs de publication en accès ouvert.
- Le tarif des différentes opérations de publication – évaluation par les pairs, tâches éditoriales, diffusion – devrait être rendu public par l’éditeur d’une revue, d’un ouvrage, afin de pouvoir
évaluer l’adéquation entre les tarifs réels des services rendus et les frais de publication en accès ouvert. - Lorsque des frais sont payés sous forme “d’APC / BPC” par les auteurs ou leur institution pour publier en accès ouvert, ils doivent être identifiés et rendus publics par les établissements et/ou
les agences de financement de la recherche, dans le cadre d’Open APC.
Les points 3 et 9 du guide d’implémentation prévoient que la transparence des coûts des APC sera un critère de compatibilité avec le Plan S.
Commentaires et recommandations sur les 10 points du Plan S
1. Les auteurs conservent les droits d’auteur de leur publication sans aucune restriction. Toutes les publications doivent être publiées sous licence ouverte, de préférence Creative Commons Attribution Licence CC BY. Dans tous les cas, la licence demandée doit satisfaire aux exigences de la Déclaration de Berlin.
Ce point est crucial car, dès lors, les auteurs sont libres de déposer et diffuser, quand ils le veulent (donc sans tenir compte d’aucun embargo) et où ils le veulent, la version finale du manuscrit accepté pour publication (ou la version publiée si l’éditeur l’autorise).
L’idéal de diffusion sous licence ouverte de type CC-BY, ou CC-BY-SA si approprié, de la version du manuscrit auteur accepté pour publication (au minimum) est à privilégier en prenant garde à ce qu’aucune cession de droits dans un contrat d’édition ne vienne le limiter ou l’empêcher (cf. point 8).
Éléments de mise en œuvre
- Fournir des modèles d’avenants aux contrats permettant de les amender dans le sens de l’autorisation d’un dépôt en archive ouverte sans embargo de la version finale du manuscrit accepté pour publication (ou de la version publiée si l’éditeur l’autorise). Les termes de ces avenants devront être repris et intégrés dans les négociations consortiales menées avec les éditeurs à l’échelle nationale par le consortium Couperin et par la cOAlition S au niveau européen.
- Informer les chercheurs et les porteurs de projets sur les licences ouvertes et la mise en œuvre des avenants.
2. Les bailleurs de fonds assureront conjointement l’établissement de critères et d’exigences solides pour les services que les revues et les plates-formes en accès ouvert conformes de haute qualité doivent fournir.
Toute publication issue d’une recherche financée par l’ANR et les autres agences qui s’engagent dans la cOAlition S devra satisfaire simultanément aux deux exigences suivantes :
- avoir bénéficié d’un processus de relecture et d’évaluation de qualité par les pairs ;
- voir son contenu diffusé en accès ouvert de manière pérenne.
Ces exigences peuvent être satisfaites par l’édition dans une revue ou un ouvrage, par le dépôt dans une archive ouverte, par le recours à une plateforme d’évaluation par les pairs, ou par une combinaison de ces différentes solutions. Par exemple : édition dans une revue sous abonnement et dépôt dans HAL ; édition dans une revue en accès ouvert ; validation par les pairs à l’aide d’une plateforme dédiée puis publication dans une revue.
Pour le choix de ces dispositifs les critères de conformité doivent être simples et aisément vérifiables par le chercheur au moment du choix de la revue dans laquelle il souhaite publier et de la plateforme de diffusion.
Éléments de mise en œuvre
Pour les revues en accès ouvert
Un premier niveau de conformité minimale devrait être prévu ainsi qu’un second niveau répondant à des exigences d’ouverture plus élevées.
Le niveau minimal de conformité comprend les éléments suivants :
- Absence d’exigence de cession exclusive des droits par l’auteur : il s’agit là du respect de ce qui est demandé au point 1 du plan S.
- Qualité scientifique de la revue. Cet élément n’est pas propre aux revues en accès ouvert mais il est fondamental et doit être rappelé. La qualité scientifique de la revue s’apprécie à la fois :
- par la qualité du travail de relecture et d’évaluation par les pairs,
- par la reconnaissance de la revue dans le champ disciplinaire (indépendamment du facteur d’impact),
- par la réalité et la qualité d’une plus-value éditoriale (matérielle et intellectuelle).
- Qualité technique et éditoriale de la revue : ce critère peut par exemple être vérifié par la présence de la revue dans le DOAJ (Directory of Open Access Journals). Il convient cependant de veiller à ce que ne soient pas pénalisées les nouvelles revues qui n’auraient pas encore été référencées dans le DOAJ.
En cas de paiement de frais de publication, transparence sur la décomposition de ces frais (nature et qualité des services – affichage clair et accessible – grille de services…).
Le niveau souhaitable comprend en outre les critères et services suivants :
- Ouverture (totale ou partielle) du processus de relecture et d’évaluation par les pairs (“Open Peer-review”).
- Politique d’accès ouvert aux données scientifiques servant de base à l’article (lien entre les données et la publication).
Pour les plateformes en accès ouvert
Archives ouvertes
Dans le cas d’un dépôt de la publication (dernière version du manuscrit auteur accepté pour publication au
minimum) dans un entrepôt ouvert, ce dernier doit obligatoirement proposer les services suivants :
- un accès immédiat et gratuit au texte sans inscription préalable du lecteur,
- un archivage pérenne et légal du contenu,
- une configuration technique qui garantit l’ouverture et l’interopérabilité des données et des métadonnées.
À cet égard, la diffusion sur les réseaux sociaux tels que ResearchGate, Academia ou MyScienceWork n’est pas compatible avec le plan S.
Plateformes d’évaluation par les pairs
Une évaluation par les pairs complète et de qualité peut être réalisée en dehors du cadre d’une revue scientifique par une communauté reconnue et organisée s’appuyant sur des archives ouvertes pour la publication. Ce mode de diffusion est compatible avec le plan S.
3. S’il n’existe pas encore de revues ou de plates-formes Open Access de haute qualité, les bailleurs de fonds fourniront, de manière coordonnée, des incitations pour les établir et les soutenir le cas échéant ; un soutien sera également apporté aux infrastructures Open Access si nécessaire.
Le soutien financier aux infrastructures, plateformes et revues de la science ouverte est indispensable et nous encourageons l’ANR, bailleur de fonds de la cOAlition S, dans ce sens. À charge pour elle de déterminer si ce soutien est effectué à l’échelle du projet (mécanismes à déterminer, cf. point 5), assumé par le bailleur sur une ligne spécifique ou par une combinaison des deux.
Ce soutien devra être apporté aussi bien à des infrastructures, plateformes ou revues existantes qu’à des dispositifs émergents. Une attention particulière devra être portée au soutien à la transition des revues, portées par des institutions publiques ou une communauté scientifique, qui ne sont pas encore en accès ouvert mais souhaiteraient le devenir, et ce indépendamment de leur modèle économique initial (abonnement payant, abonnement avec barrière mobile, APC…)
Éléments de mise en œuvre
- Que ce soit pour encourager la création de nouvelles infrastructures, plateformes et revues, pour en favoriser la conversion à un modèle ouvert ou pour soutenir celles déjà existantes, l’ANR, membre de la cOAlition S, doit être attentive au respect de critères d’exemplarité en cours de définition au sein du CoSO à échéance du premier semestre 2019, et établis dans le sens :
- d’un contrôle par la communauté scientifique,
- de garanties de transparence en termes de gouvernance, d’organisation, de coûts et de pilotage favorisant leur qualité et leur pérennité
- de l’inscription dans une forme juridique les protégeant d’un rachat éventuel,
- de l’utilisation préférentielle de logiciels libres,
- du respect de standards et de normes ouverts pour les données et les métadonnées et de la mise à disposition d’APIs ouvertes.
4. Le cas échéant, les frais de publication de l’accès ouvert sont couverts par les bailleurs de fonds ou les universités, et non par des chercheurs individuels ; il est reconnu que tous les scientifiques devraient pouvoir publier leurs travaux en accès ouvert même si leurs institutions disposent de moyens limités.
Cette disposition présente un risque de dérive vers un modèle entièrement fondé sur la publication payante dont le prix sera difficilement maîtrisable s’il n’est pas associé à des services dont les tarifs sont justifiés par l’éditeur (cf. supra : transparence).
Des frais de publication “vertueux”, transparents et en rapport avec les services rendus, sont, par contre, acceptables car éditer et publier a un coût.
La solution que nous défendons et qui est prônée par l’Appel de Jussieu est de favoriser le financement collectif de plateformes et revues qui ne demandent pas aux auteurs de payer.
5. Lorsque des frais de publication en Open Access sont appliqués, leur financement est standardisé et plafonné (à travers l’Europe).
Il existe sans doute un risque d’alignement des prix sur le plafond ; en conséquence celui-ci devrait être ajusté au plus bas, tout en permettant de construire des modèles durables avec les éditeurs.
Par ailleurs un plafonnement moyen n’a pas de sens en termes disciplinaires et un travail sur la réalité des coûts de publication au plus près des spécificités disciplinaires et nationales s’impose.
Le plafonnement, de notre point de vue, ne peut donc être que disciplinaire et il paraît préférable que l’ANR en fixe le montant pour chaque discipline dans ses règles nationales ou délègue cette charge à ses sections disciplinaires dans le cadre de l’examen des dossiers.
Il conviendra de fournir aux évaluateurs des éléments d’appréciation des modèles et des tarifs des services d’édition.
Dans le cas de la mise en place d’un plafonnement, que nous ne concevons que bas, il conviendra de prendre effectivement en compte le cas des revues en libre accès ne demandant pas de frais de publication et qui sont aujourd’hui majoritaires dans certaines disciplines.
Éléments de mise en œuvre
- Pour éviter le nivellement par le haut, nous préconisons que l’argent non dépensé sur la ligne “publications” d’un projet, puisse être utilisé sur les autres lignes et non l’inverse (principe de fongibilité asymétrique).
- Il paraît nécessaire de demander la transparence des tarifs de publication afin de mettre en relation les montants demandés et la réalité des services rendus.
- Pour que la transparence ait du sens il faut construire par discipline une grille des tarifs effectifs des services : processus d’évaluation, édition matérielle et publication, acceptable par tous. Cette grille doit être construite avec les éditeurs publics, les sociétés savantes et autres acteurs de l’édition en accès
ouvert. Le CoSO contribuera à cette tâche collective. - Nous recommandons que le travail sur la transparence des tarifs soit coordonné au niveau des acteurs de la cOAlition S et prenne en compte la réalité des négociations.
- Pour que la transparence ait du sens il faut construire par discipline une grille des tarifs effectifs des services : processus d’évaluation, édition matérielle et publication, acceptable par tous. Cette grille doit être construite avec les éditeurs publics, les sociétés savantes et autres acteurs de l’édition en accès
6. Les bailleurs de fonds demanderont aux universités, aux organismes de recherche et aux bibliothèques d’aligner leurs politiques et stratégies, notamment pour assurer la transparence.
S’il s’agit d’un alignement au niveau européen, il faudra veiller à ne pas aller vers un modèle unique de développement de l’accès ouvert mais bien à soutenir la bibliodiversité dans le respect des particularités disciplinaires.
Nous recommandons également de veiller :
- à partager les principes de transparence définis dans les préconisations générales et principalement dans les points 2 et 5 ;
- à rendre communs et à harmoniser les principes de transfert des économies d’abonnement vers le soutien à la production éditoriale ;
- à converger vers des principes innovants et vers une harmonisation des modes et des pratiques d’évaluation de la recherche dans le sens des recommandations de DORA ;
- à ce que les négociations consortiales menées avec les éditeurs favorisent la mise en œuvre du Plan S pour les auteurs des institutions ou du pays concerné.
7. Les principes ci-dessus s’appliquent à tous les types de publications savantes, mais il est entendu que le délai pour parvenir à l’accès ouvert pour les monographies et les livres peut être supérieur au 1er janvier 2020.
La date du 1er janvier 2020 semble peu réaliste en regard de la temporalité de production des monographies. De plus, en l’absence d’une approche raisonnée et quantifiée des pratiques d’édition
d’ouvrages, il est urgent de mener une étude sur l’économie, les modes d’édition et les frais de publication en accès ouvert des monographies, à la suite de laquelle il pourra être envisagé de fixer une date et des mécanismes pour que les monographies de recherche subventionnées par l’ANR soient diffusées en accès ouvert. Une attention particulière devra être portée aux modèles économiques innovants.
Par contre, pour les ouvrages collectifs nous estimons que leur cas peut, d’ores et déjà, être assimilé à celui des articles de revues avec la possibilité de dépôt, sur le modèle des articles, des chapitres en archives ouvertes.
Éléments de mise en œuvre
- Réaliser une étude sur l’économie, les modes d’édition et les frais de publication en accès ouvert des monographies, en s’alignant sur les principes énoncés dans les “Préconisations générales” et au point 5 pour l’établissement de la transparence des coûts. Cette étude doit être menée avec les éditeurs publics, les sociétés savantes et autres acteurs de l’édition en accès ouvert.
- Nous préconisons par ailleurs de se rapprocher des presses universitaires pour envisager, sur la base de leur expérience, la mise en œuvre de mécanismes de publication d’ouvrages nativement en accès ouvert et pouvant utiliser des modèles économiques alternatifs tels que définis par Operas (Open Access Business Models White Paper), comme le modèle Freemium, le financement participatif par les bibliothèques…
- Réaliser un projet pilote sur les ouvrages.
8. L’importance des archives ouvertes et des dépôts d’archives pour l’hébergement des résultats de la recherche est reconnue en raison de leur fonction d’archivage à long terme et de leur potentiel
d’innovation éditoriale.
Il faut faire des archives ouvertes le lieu privilégié de diffusion des publications financées par l’ANR et l’ensemble des membres de la cOAlition S.
Dans ce sens, il convient pour l’ANR d’exiger contractuellement un dépôt systématique ou un reversement automatique dans HAL à partir d’une autre archive ou de toute autre source.
Nous préconisons donc, pour les articles acceptés pour publication, la diffusion en archive ouverte immédiate et sans embargo dès la publication au minimum du texte intégral de la version finale du manuscrit accepté pour publication ou, idéalement, de la version ‘éditeur’ (exemples vertueux de EDP Sciences et de l’American Physical Society).
L’importance des archives ouvertes va en effet bien au-delà la fonction d’archivage à long terme des articles publiés. C’est notamment :
- le moyen le plus rapide de diffuser des résultats, éventuellement avant acceptation ou publication ;
- le terreau de nombreux projets innovants aussi bien, par exemple, dans le domaine des épirevues (Episciences…) que dans celui des modes d’évaluation (Peer Community In…) et d’autres à venir(cf. Appel de Jussieu et sa mise en oeuvre) ;
- la promesse – moyennant la réalisation de l’interopérabilité – d’un corpus transcendant les frontières entre catalogues et facilitant ainsi l’accès de la documentation à tous et la fouille de texte ;
- une vitrine institutionnelle permettant de rassembler la production scientifique d’un établissement dans un lieu unique ;
- un outil pour le chercheur pour stocker et diffuser sa production personnelle et éditer ses rapports.
9. Le modèle « hybride « de publication n’est pas conforme aux principes ci-dessus.
Ce modèle, très opaque, conduit, dans le cas de la mise en accès ouvert, à un double paiement qui ne peut être acceptable.
Cependant un grand nombre de revues relevant de ce modèle économique sont, pour le moment, les revues-phares de communautés scientifiques entières et disposent d’une notoriété élevée, donc d’un fort pouvoir d’attractivité. Sans, au moins, une évolution rapide et radicale des procédures d’évaluation de la recherche, il paraît donc illusoire de penser inverser cette situation d’ici le 1er janvier 2020.
Éléments de mise en œuvre
Il nous paraît donc plus réaliste, dans l’immédiat :
- de communiquer et informer les chercheurs de l’existence et du fonctionnement de ce modèle économique hybride que la majorité d’entre eux ignore ;
- de rappeler aux chercheurs que le dépôt et la diffusion en archive ouverte est totalement compatible avec le Plan S et ne nécessite aucun paiement de frais de publication pour la mise en accès ouvert ;
- de rappeler aux chercheurs que la publication dans une revue hybride, sans s’acquitter des frais de publication en libre accès, mais assortie à un dépôt en archives ouvertes est compatible avec le Plan S ;
mais également :
- de souligner que ces revues doivent être soumises au même niveau d’exigence de qualité que les revues en accès ouvert mentionnées au point 2 ;
- de soutenir l’exigence d’une diminution du prix des abonnements et / ou des frais de publication pour ces revues, prenant en compte leur double financement et en rapport avec le service réel rendu (cf. “Préconisations générales” : transparence des tarifs) ;
- d’inciter les éditeurs de ces revues hybrides à mener, avec des échéances précises, leur transformation en revues à accès ouvert intégral.
10. Les bailleurs de fonds surveilleront la conformité et sanctionneront les cas de non-conformité.
Un système de suivi, assorti d’éventuelles sanctions, ne peut qu’appuyer la mise en œuvre du Plan S. Les modalités de suivi et la forme de ces sanctions ne peuvent être déterminées que par les bailleurs de fonds eux-mêmes.
Nous recommandons à l’ANR de vérifier, au moment du bilan du projet, et le cas échéant au moment de l’évaluation du projet (livrables liés à l’édition de sources par exemple), que les publications sont bien conformes et donc les dépenses recevables.
Il pourrait être envisagé de n’ouvrir la ligne prévisionnelle de financement des publications qu’a posteriori et sous réserve de vérification de conformité.
L’ANR pourrait, comme c’est le cas pour des fonds européens, créer un fond mutualisé pour le financement des publications, qui sont souvent publiées après la vie d’un projet.
L’ANR et les autres membres de la cOAlition S pourront également faire des bilans globaux de l’application du plan, par exemple annuellement, et sur la base de ce bilan prendre des mesures d’ajustement.
Le plus important à ce stade nous paraît être la pédagogie et l’accompagnement, pour dire clairement aux chercheurs comment ils peuvent se conformer au Plan S.
Lettre de Thierry Damerval, Président Directeur Général de l’ANR, à Bernard Larrouturou, Directeur général de la recherche et de l’innovation (30 octobre 2018)